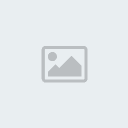Le thème de la souffrance s’est imposé avec la lecture de certains livres ou l’écoute d’émissions de radio, ceci entrait en résonance avec des discussions qui se sont déroulées en divers lieux. La forme est restée celles de notes, parce que l’approche n’est pas exhaustive ni définitive, ce serait plutôt une entrée en matière. La dynamique se construit par un mouvement théorie / la pratique et des débats.
La souffrance actuelle ne peut se séparer de la domination. Le capitalisme est un monde cruel. La réalité de la souffrance interroge la définition de l’humain. Transmettre et construire l’humanité implique de prendre cela en charge. Tenter de diminuer la souffrance humaine en luttant contre l’oppression et l’exploitation, c’est le lot des révolutionnaires. L’égalité est une valeur, une valeur politique et éthique, c’est un désir qui impose de se demander pourquoi l’injustice, la souffrance et l’inégalité sont-elles aussi facilement produites et reproduites.
Avec la souffrance on est obligé de se confronter au fait que la rationalisation de ce monde va l’encontre de la rationalité. Avec ce phénomène on peut comprendre l’articulation entre les différentes sphères qui composent l’humain : économique, sociologique, politique, culturelle, idéologique, linguistique et psychologique, etc. Une seule approche est insuffisante, la souffrance a plusieurs dimensions. L’exemple de la virilité est particulièrement éclairant, on passe d’une vertu à l’identitaire dans son utilisation par le système.
Toutes ces analyses ou ces compte-rendus confirment que la subjectivité est mobilisée par la domination, que la société a changé, que la société disciplinaire a laissé la place à une société plus libérale où la soumission ne passe pas seulement par une contrainte ouverte et directe, que l’individu-e est un élément clé du fonctionnement du pouvoir. Ceci interroge évidement les thèses qui disent prendre appui sur l’individu-e comme base de la révolte. Ceci explique aussi pourquoi la révolte n’est pas mécanique en situation d’oppression et d’exploitation.
A travers ces approches le sentiment d’approcher un peu plus l’humanitude est très fort, au-delà de la mélancolie il y a bien cet universel humain que nous cherchons toujours à atteindre. Ici c’est par la voie négative que l’on essaie alors d’approcher la notion d’humanité. Nous affirmons ce que nous refusons et nous savons un peu mieux ce que nous voulons. La souffrance est une réalité ancienne et abordée depuis longtemps dans le mouvement révolutionnaire. Ce qui est nouveau, ce sont les formes qu’elle prend : la généralisation de la souffrance mentale. Nous avons besoin de nouvelles analyses pour compléter ce que les personnes vivent et peuvent exprimer. En général le passage à la conscience nécessite un arrêt, une mise à distance et une parole collective pour pouvoir assumer cette réalité publiquement. Les écrits qui suivent n’émanent pas de personnes qui ne se disent pas révolutionnaires, mais ils peuvent nous être utiles.
I / La flexibilisation, (une émission sur France Culture le 6 2 99)
La flexibilisation c’est un processus plus large que la flexibilité. Sa caractéristique principale : l’individualisation des personnes au travail. C’est la mise sur la même plan des employeurs et des employé-es. La force, la puissance est inégale, c’est l’illusion d’un contrat égal entre des puissances disproportionnées. Ce fait est dénoncé depuis longtemps les critiques du capitalisme (Bakounine, Marx et les autres).
En Angleterre la flexibilisation s’est appuyée sur un discours ouvertement néolibéral. En France elle s’est développée quelques années plus tard avec un discours de progrès social, discours véhiculé par la gauche. C’est au nom de l’individu-e, de son autonomie que la législation à temps partiel a été adoptée au début des années 80. Ce sont deux variantes du même processus.
Ceci passe par des modalités pratiques très différentes : temps partiels, contrat à durée déterminée, stage, intérim, augmentation de la période probatoire avant l’embauche définitive, etc. Il y a une augmentation du temps de mise à disponibilité des travailleurs-euses pour l’employeur : passage de 5 à 6, voire 7 jours de possibilité de travail dans la semaine, annualisation, augmentation de la plage horaire de disponibilité dans la journée, lutte contre l’absentéisme, etc. La durée du travail change, elle est morcelée pour les temps partiels (caissières par exemple), elle augmente pour les cadres. On ne doit pas non plus oublier la tendance à transformer les salariè-es en travailleur-euses indépendant-es à leur compte.
On constate plusieurs processus conjoints dans cette flexibilisation : l’atomisation des individu-es entre eux ou elles, l’implication plus grande des personnes. Cette implication demande une intériorisation plus grande des normes du combat pour la compétitivité, une adhésion aux valeurs du marché, de l’entreprise. Ceci se traduit dans le travail par une intensification physique et psychique de travail. Les contraintes physiques augmentent : gestes répétitifs très rapides, par exemple, avec les maux qui s’en suivent. La chasse aux temps non travaillés (pauses, mouvements inutiles, temps morts, etc.) est permanente. L’augmentation de la charge psychique est nette. La pression mentale est de plus en plus forte sur les personnes au travail. La société de l’information ce n’est pas seulement un mythe moderniste, elle a des effets pratiques puissants. Ceci passe par une la mobilisation de la subjectivité de plus en plus grande. Les conséquences sont connues des médecins du travail : sentiment de tête vide, l’anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, difficulté de concentration, prises de médicaments pour se calmer ou se stimuler, etc. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, la sensation de ne pas pouvoir vivre sa vie sont assez communs. L’augmentation du nombre de dépressions peut être mise en relation avec la flexibilisation. La culpabilisation est forte surtout sur les personnes qui refusent, renâclent ou qui parfois osent se battre contre ces injustices. La déstructuration de la vie sociale due aux horaires flexibles peut entraîner une sensation de désocialisation. Comment s’occuper correctement de ses enfants avec ces horaires imbéciles ? Comment avoir une vie de couple si on se croise ? Comment avoir des ami-es quand on a des horaires qui changent tout le temps, qui ne sont pas en phase avec une vie sociale « classique » ?
La souffrance est réelle. Ce qui est paradoxal, en apparence, c’est que c’est au nom de l’autonomie individuelle, de la prise de responsabilité, du progrès social que cette flexibilisation se fait. On voit bien la complémentarité entre la psychologie individuelle et l’ambiance externe de la société. Ce point est relevé par les analyses sur le caractère mouvant de la situation des jeunes qui sont habitués à vivre « flexibles ». Ce serait cela leur « capital », contrairement aux générations précédentes où le niveau de savoir était important. On retrouve tous les constats mis en évidence par le mouvement des chômeurs, chômeuses et précaires de 1998.
Je pense que le combat de classe est conjoint de la fin de la massification, de la mise en oeuvre de la malléabilité des travailleurs-euses, de l’implication, déjà constatée, de plus en plus forte faite à la sphère subjective : projet, qualité, responsabilisation, etc. Le capitalisme évolue, la sphère économique est lié aux autres sphères de nos sociétés. Il existe un lien entre les domaines idéologiques, culturels, économiques et politiques même si ce lien n’est pas mécanique, même si on ne peut pas dire que l’un des domaines est plus fondamental que les autres. La domination individualise, les individu-es vivent et pensent dans le système, plus ou moins bien il est vrai. La notion de combat de classe est légitime parce qu’il me semble que les dominants, eux, le continue et que cette perspective, débarrassée de son aspect économiste, est toujours valide pour les personnes dominées.
Je constate une convergence entre diverses analyses : les analyses sur la fin de la centralité du travail (la revue Temps Critiques , Méda, Gorz, etc.), les analyses basées sur la biopolitique (Giorgio Agemben, etc.), les analyses sur le « Général Intellect » de Paolo Virno, les analyses sur les modifications des modes de domination (Foucault, Deleuze / Guattari, etc.), les analyses sur la gestion des populations (Didier Bigo), etc.
L’attention à la souffrance est importante. Cette démarche participe d’une reprise du problème de ce que l’humanité vit et comment elle le vit pour poser de nouveau des questions de fond. Cette démarche déplace l’approche habituelle des problèmes et peut permettre de reposer des questions clés, où la question : qu’est-ce qu’être humain ? implique toujours de parler politique. La précarité interroge la société, comme le fait d’avoir ou non des papiers, d‘avoir ou non un revenu. La question du sens a ici une incidence pratique.
II / La dépression mal de la fin du siècle, (France Culture le mercredi matin 3 Février 1999)
Selon Alain Erhenberg; l’auteur du livre sur la dépression : « La fatigue d’être soi », éditions du Seuil, Paris, 1998, il note une modification de place de l’individu-e conjointe à l’évolution de la société. La dépression est ainsi définie comme la sensation du malheur intime (parfois très profond). Il y a bien un changement dans le rapport entre l’individu-e et la société.
La base de la névrose c’était la difficulté avec l’interdit, entre le permis et le défendu. Ce qui provoquait en soi des conflits, une culpabilité puisqu’on désirait des interdits. Il s’agissait d’un rapport à l’autorité et d’une société disciplinaire, selon les termes employés par l’auteur. Aujourd’hui il s’agirait d’un rapport entre le possible et l’impossible. On parle beaucoup d’initiative personnelle, d’autonomie. L’individu-e, souvent, ne se sent pas à la hauteur. La dépression est un mal de l’insuffisance. La psychiatrie annonce que ce malaise mental est très répandu actuellement dans le monde. C’est une difficulté liée à l’estime de soi. Les formes vont de l’attirance pour la mort et le suicide à l’incapacité plus ou moins sévère. Le traitement va chercher à « regonfler » la personne, d’où le succès des stimulants divers et variés, des thérapies visant le développement personnel.
Les constats en maladie mentale complètent les analyses sociologiques et politiques : passage de la société disciplinaire à la société de contrôle, passage de la société de masse à l’individualisation, atomisation, etc. Certains psychanalystes notent que les troubles liés au narcissisme se généralisent, d’autres que les névroses sont en perte de vitesse face aux psychoses.
C’est à mettre en lien avec le culte du corps et de la jeunesse déjà connu ou la gestion de soi, de sa vie. La beauté, l’esprit sont pensés comme un capital à entretenir, développer. Les affects sont gérés sous le signe de l’intérêt. Le « soi » doit se vendre et se mettre en image. L’individualisme des temps présents dans cette société marchande et spectaculaire est un bon relais pour la domination.
III / « Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien », Marie-France Hirigoyen, Éditions Syros, Paris, 1998
Ce livre parle essentiellement des situations de travail et familiales, j’ai transposé et librement adapté ces analyses à partir du milieu militant où le harcèlement existe aussi.
L’agresseur, (désolé, mais c’est souvent un homme !) :
- est narcissique (voire pervers dit Mme Hirigoyen, ne serait-ce pas le fameux « moi je » bien connu ? ),
- se veut référent, témoigne d’une volonté de vérité à toute épreuve,
- affecte un air supérieur et distant, possède une sûreté désarmante (même si ce n’est qu’une apparence), a une voix blanche,
- utilise la séduction, le charme,
- met en oeuvre une stratégie pour être au centre de l’attention,
- s’attaque à l’estime de soi des autres pour augmenter sa valeur à lui ou à elle (il arrive que les filles s’y mettent aussi), cherche à déstabiliser, sape le moral petit à petit,
- ne procède pas par l’attaque ouverte (du moins au début), parle à mot couvert, mais installe facilement le malaise en vous mettant dans la confidence, opère par l’assemblage de sous-entendus, si besoin crée une ambiance désastreuse,
- aime la controverse (celle-ci prend souvent la forme d’une polémique où la hargne et la rage de convaincre cherchent en fait la soumission),
- change de point de vue facilement (sans le reconnaître évidemment),
- se présente souvent comme agressé, inverse les rôles (la confusion règne, ni vu ni connu je t’embrouille !), utilise l’effet miroir pour projeter sur sa victime ses propres défauts,
- culpabilise (méthode bien connue, mais qui marche),
- met la pression (le stress, rien de tel pour être efficace !),
- s’appuie sur un précepte très répandu dans notre société : « l’efficacité avant tout ! » (ceci n’a-t-il pas à voir avec la raison instrumentale et l’instrumentalisation si fréquemment rencontrée ?),
- sa ligne de conduite : « la fin justifie les moyens ! » (c’est valable pour les cadres du système capitaliste, mais n’est-ce pas le cas aussi pour toutes les élites, y compris celles du milieu militant et pas seulement les léninistes ? ), etc.
La victime :
- n’est pas une personne spécialement soumise,
- est souvent une forte personnalité (voire une grande gueule dit Mme Hirigoyen !),
- est à l’écoute des autres,
- est dévoué-e, connu-e pour son investissement altruiste,
- ne se met pas systématiquement en avant,
- ne cherche pas forcément à avoir le dernier mot,
- résiste à l’occasion, refuse dans ce cas les pressions d’où qu’elles viennent (du sommet ou de la base),
- prend sur elle (le sacrifice c’est normal, la cause c’est sacré ! ),
- se dit que c’est de sa faute,
- n’y croit pas (oh, c’est pas possibbe !),
- doute d’elle-même sans cesse et se pose souvent des questions sur ce qu’il faut faire ou pas (ceci va parfois jusqu’à la torture mentale),
- reste dans le silence parfois très longtemps,
- accumule les rancoeurs (je suis dégoûté-e !),
- pense que ça va finir par changer dans le bon sens, donc qu’il faut encore attendre, que tout n’est pas aussi mauvais que ça en ce bas monde,
- a une attitude où l’effacement et la culpabilisation sont complémentaires du sacrifice militant,
- ne cherche pas l’efficacité à tout prix,
- estime que les personnes qu’elle rencontre sont intéressantes pour elles-mêmes,
- pense qu’être bien ensemble ce n’est pas négligeable (ouais, cool !), etc.
Le conseil de Mme Hirigoyen : « Ne faîtes pas le dos rond ! », « Si besoin partez ! »
IV / Souffrances en France, la banalisation de l’injustice sociale, par Christophe Dejours, Éditions du Seuil, Paris, 1998.
La souffrance dans le travail est son point de départ. Ses conclusions me semblent valides pour d’autres domaines. Le lien entre le travail et le reste de la société est clairement montré. La liaison entre la virilité et la violence est mise en évidence, elle est même considérée comme la base de sa critique. Il parle clairement du cynisme viril, autre nom du machisme. La référence aux travaux de Wetzer-Lang est explicite. L’auteur fait une différence entre le genre et l’identité sexuelle, parce qu’un homme peut réfléchir sur le genre, refuser le machisme et garder son d’identité sexuelle masculine.
Il cherche à découvrir l’origine du consentement de cet étrange silence : la peur, puis la honte. Pour faire fonctionner la machine capitaliste nous commettons des actes que pourtant nous réprouvons. Il essaie de comprendre comment pour pouvoir vivre la souffrance sans perdre la raison, on se protège. Dans le cadre mental contemporain la vie serait un combat, éliminer les « mauvais-es » serait normal au nom de la compétitivité.
Il ne veut pas convaincre les dirigeants. Il s’oppose à la naturalisation du phénomène qui tendrait à faire croire que le lien entre l’économie actuelle et la nature humaine c’est la dominance, qui, bien sûr, serait intangible et inattaquable. Il pose la question de la souffrance et de sa normalité. Deux questions sont essentielles : en premier lieu pourquoi accepte-t-on de souffrir ? et deuxièmement pourquoi accepte-t-on de faire souffrir ?
Il constate que l’on répugne à faire souffrir, mais qu’on le fait quand même. Il essaie de comprendre les ressorts du consentement dans le cadre de l’absurdité du sens de notre société. La souffrance est vécue comme normale et non comme une injustice, elle n’entraîne pas de réaction politique. Ce qui domine c’est la résignation, elle délie la souffrance de l’injustice, elle empêche le passage à la sensation de responsabilité. La souffrance reste cantonnée dans le vécu psychologique alors que l’injustice est à référer à l’éthique de la collectivité, au champ social.
Tout ceci est corollaire de la croyance au discours ambiant qui fait autorité, discours qui légitime le libéralisme, le marché et la compétition économique. Ce qui fait problème c’est ce qu’il nomme « la banalisation du mal » . Cette banalisation est importante puisqu’elle constitue en elle-même un mécanisme de défense contre la conscience malheureuse. Elle permet d’annihiler sa responsabilité propre. Il récuse la notion d’impuissance au profit de la notion de défense collective contre la souffrance. Le cadre mental c’est bien ce combat de classe qui maintient la domination (enfin c’est ainsi que j’ai compris son propos). L’espace public est en cause, parce qu’individuellement on peut dire non. On assiste bien à une transformation qualitative de la société, la normalité est devenue une normalité souffrante. Cette normalité souffrante repose sur plusieurs phénomènes :
1 / Le déni politique et syndical, la souffrance est déniée dans les analyses des organisations syndicales et politiques.
2 / Ce qui entraîne la honte et l’inhibition de l’action collective face à la souffrance. Comme il est impossible de la reconnaître, il existe une grande tolérance à son égard. le sujet souffrant s’isole et devient indifférent à sa propre souffrance comme à celle des autres.
3 / On comprend alors l’émergence de la peur et de la soumission au niveau individuel. La menace de licenciement induit la peur. Le mécanisme de défense c’est « le déni de la souffrance des autres et le silence sur la sienne propre » La vie dans la peur est le résultat de la nouvelle forme de domination : « cette peur est permanente et génère des conduites d’obéissance, voire de soumission ». Elle casse la réciprocité entre travailleurs (autre nom de la solidarité, à mon avis) et produit « une séparation subjective croissante entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas ».
4 / On passe ensuite de la soumission au mensonge. Ceci s’opère par, en premier lieu, le maniement de la menace pour obtenir l’intensification du travail. Pour fonctionner notre système a besoin du zèle des participants au travail comme du temps des nazis. La peur est utilisée comme ressort de l’intelligence. « Les difficultés dans l’organisation de la production existent bel et bien, les tensions sont certaines, les résultats sont obtenus à l’arraché, la souffrance des salariés statutaires, comme celle des travailleurs en emplois précaires est authentique, mais le système fonctionne et semble à même de pouvoir durablement fonctionner sur ce mode. »
En second lieu le consentement des cadres est indispensable, mais leur perplexité est réelle.
5/ Le mensonge institué est une réalité. Le management « à la menace » étayé sur la précarisation de l’emploi, favorise le silence, le secret et le chacun pour soi. Le mensonge est produit à partir des résultats et non pas à partir de l’activité humaine qui a permis d’obtenir ces résultats. La justification s’opère avec les arguments gestionnaires et commerciaux. Tout le discours est semblable à une communication externe et ne prend pas en compte la vie interne réelle. Le problème central c’est l’image. Ici on retrouve le poids de la société du spectacle.
L’euphémisation du travail réel et de la souffrance s’appuie sur un phénomène nouveau : la fragmentation par « centres de résultats », par « direction d’objectifs ». C’est ce qu’analyse Le Goff dans ses travaux sur l’idéologie du management . La notion de projet est centrale. Chaque personne est requise pour produire et diffuser le mensonge. La discipline c’est soutenir le message de valorisation dit-il. Ici la discipline est donc mentale plus que physique. L’effacement des traces est nécessaire. Les « anciens » sont un danger, il faut les écarter, les priver de responsabilités, voire les licencier ou les mettre en retraite anticipée. Il est étonnant de constater comment ces méthodes existent un peu partout, pour les femmes opprimées, ou battues, par exemple, la vérité doit rester privée. Dans les mouvements associatifs ou militants, il ne faut pas parler de certaines choses, car cela nuirait à la cause et on entretient le silence.
La communication interne est basée sur des pratiques discursives bien identifiables : « La justification des documents lapidaires, simplificateurs, voire simplistes, ou tapageurs, repose sur le même argument, constamment convoqué dans tourtes les organisations : les gens n’ont pas le temps de lire ni de se documenter; il faut donc aller au plus court pour ne pas les surcharger et pour pouvoir avoir une chance d’être entendu lu ou simplement repéré. » .....« Les lecteurs sont considérés, a priori, comme des ignorants, voire des crétins. Qu’ils le restent surtout ! Pas de vagues, pas de subtilités, susceptibles d’éveiller la curiosité, le questionnement la perplexité. »
On croirait lire une critique de « l’agit-prop » . Combien de fois n’a-t-on pas entendu qu’il fallait faire simple, que les questions posées étaient trop compliquées ?
Pour faire passer ses réformes on utilise l’image. « Le recours à l’image sollicite le fonctionnement imaginal et la capture imaginaire en lieu et place de la réflexion, de la critique, de l’analyse et, plus généralement, de l’activité de penser avec laquelle l’imagination entre en concurrence. »
La rationalisation est étape importante du processus d’acceptation de la souffrance. Elle permet d’expliquer pourquoi on dépense autant d’argent et d’énergie dans la communication. La communication même si on sait qu’elle est mensongère est acceptée, elle transmet un conformisme généralisé. Ceci rappelle « la montée de l’insignifiance » dont parle Castoriadis. L’efficacité du mensonge est étonnante dans la mesure où beaucoup de gens savent que c’est un mensonge. L’explication de ce paradoxe tient au fait qu’elle permet la rationalisation de l’acceptation du mensonge. Pour faire face au danger que représente la souffrance et à celui plus grand encore de perdre sa dignité (en faisant souffrir les autres) il est fondamental de trouver une parade. Ainsi s’explique ce besoin de rationaliser le consentement.
Cette analyse est quasi-identique à celle de Jean Léon Beauvois sur « La servitude libérale ». Celui-ci explique que pour se soumettre volontairement les humains ont besoin de deux choses : premièrement la déclaration de liberté, en second lieu les hautes justifications humaines qui permettent de rationaliser la soumission (pas les actes en eux-mêmes).
Ici Dejours envisage la rationalisation comme une défense nécessaire pour supporter la souffrance. La « rationalisation » désigne ici une attitude psychologique. Dans le cas présent, la rationalisation est une justification à vocation collective, sociale et politique. La notion de justification globale est bien notée, elle fonctionne un peu partout : « En substance, il s’agit, par la rationalisation, de démontrer que le mensonge, même s’il est regrettable, est un mal nécessaire et inévitable. » La rationalité invoquée dans le monde du travail est celle de la raison économique. Il remarque aussi « qu’elle s’insinue, presque toujours, dans d’autres considérations, rattachées à la rationalité sociale, en vertu de principes fort douteux au plan moral-pratique. »
Il dénonce la valorisation du mal. Le mal c’est la tolérance au mensonge, le concours à sa production et à sa diffusion. Le mal c’est la tolérance, la non-dénonciation et la participation à l’injustice et à la souffrance infligée à autrui. On peut se référer facilement au livre sur le harcèlement cité plus haut, où ces pratiques sont pointées et décrites par le menu.
« Nous qualifions de « mal » toutes ces conduites lorsqu’elles sont :
- érigées en système de direction, de commandement, d’organisation ou de management, c’est à dire lorsqu’elles supposent l’implication de tous aux titres de victimes, de bourreaux, de victimes et de bourreaux alternativement ou simultanément ;
- publiques, banalisées, conscientes, délibérées, admises ou revendiquées, et non pas clandestines, occasionnelles ou exceptionnelles, voire lorsqu’elles sont considérées comme valeureuses. »
Est-ce limitée au monde du travail ? A mon avis, c’est quasi-général en ce monde.
Pour lui l’enrôlement des braves gens est une difficulté. Le rôle des leaders est clair, il n’y pas de doute. Souvent leur psychologie est pathologique, mais pour les intermédiaires leur collaboration reste problématique. Il existe bel et bien un « dispositif spécifique pour enrôler et mobiliser les braves gens dans la stratégie du mensonge, dans les stratégies de licenciement, dans les stratégies d’intensification du travail et dans le viol du droit du travail sous la houlette des leaders. »
Comme on ne peut pas prendre plaisir à faire « le sale boulot », on fait appel au courage pour accomplir ce sale boulot. La modalité du courage est importante et fondamentale dans tout ce processus. La mal et le courage sont donc associés dans notre monde. Le courage est une vertu fortement valorisée ; mais comment peut-on faire passer pour une vertu de courage une conduite qui consiste à faire subir une injustice à autrui?
Pour comprendre ce phénomène il se réfère au livre de Browning sur le 101° bataillon où il est explicitement noté que l’on fait le sale boulot (à ce moment là l’extermination de juifs) parce qu'on ne veut pas passer pour un lâche. L’explication est donc là : « le retournement de la raison éthique ne peut être soutenu publiquement et emporter l’adhésion des tiers que parce qu’il est fait au titre du travail, de son efficacité et de sa qualité. » Si le gendarme du 101° bataillon commettait ce qu’il a fait en son nom personnel il aurait été unanimement condamné. Mais il le commettait au nom du travail, « cela pouvait passer pour « désintéressé », voire pour l’intérêt d’autrui, de la nation, du bien public. »
On retrouve ici la thèse de Beauvois sur la servitude libérale, voici ce qu’il énonce : « Notre propre analyse avait l’exercice du pouvoir comme objet (et non l’efficacité de la relation de pouvoir), c’est à dire le type de fondement des prescriptions et des évaluations d’un agent qui a délégation de pouvoir, et la mise en avant d’une légitimité de cet exercice pouvait être posé comme générale, intransitive, comme valeur finale. La puissance, les grandes causes et les individu-es fournissent bien en effet de telles légitimités intransitives. Cette référence correspond à ce que nous appelons la dimension idéologique de l’exercice du pouvoir. »
« Il apparaît ainsi qu’un maniement de la liberté des agents soumis par les agents d’autorité peut fort bien, non seulement manquer à les transformer en être autonomes, mais encore les amener à attribuer de la valeur à leur comportement d’agent soumis. » Pour lui il est important de développer une « théorie de la dissonance cognitive. » Il faut évoquer « l’idée de la rationalisation de la conduite [de soumission]. »
De grandes causes qui donnent de la valeur aux individu-es, n’est-ce pas ce que décrit Dejours ? La distorsion de la raison morale est un autre point de similitude. Beauvois y ajoute la déclaration de liberté. Dejours insiste à plusieurs reprises sur le fait qu’il analyse la souffrance dans le système néolibéral et non sous le nazisme. On voit bien dans les deux cas que l’analyse de la soumission c’est la tentative de compréhension des mécanismes du fonctionnement du pouvoir.
Pour expliquer le retournement de la raison éthique Dejours pense qu’il faut étudier la rationalité psychoaffective (nommé aussi rationalité pratique). L’ingrédient principal de la réaction peut être identifié facilement : « il porte le nom de « virilité » ». « La virilité se mesure précisément à l’aune de la violence que l’on est capable de commettre contre autrui, notamment contre ceux qui sont dominés, à commencer contre les femme.» ... « Est un homme, est un homme véritablement viril, celui qui peut sans broncher, infliger la souffrance ou la douleur à autrui, au nom de l’exercice, de la démonstration ou du rétablissement de la domination du pouvoir sur l’autre; y compris par la force. » ... « Bien entendu, cette virilité est socialement construite et doit être radicalement distinguée de la masculinité qui se définirait précisément par la capacité d’un homme à se distancier, à s’affranchir, à subvertir ce qui lui prescrivent les stéréotypes de la virilité. »
Le recours à la virilité permet de faire passer le mal pour le bien. « C’est par la médiation de la menace de castration symbolique que l’on parvient à retourner l’idéal de justice en son contraire. » Il remarque que la virilité relève d’une autre dimension que celle de l’intérêt économique, il constate que l’analyse strictement sociologique ne peut expliquer ce qui se passe. « Exclure la dimension de la souffrance subjective des analyses philosophiques et politiques n’est pas tenable. »
La souffrance n’est pas une conséquence, au contraire elle est première : « La souffrance est première. Car au-delà de la souffrance, il y a les défenses. Et les défenses peuvent être redoutablement dangereuses, en ce qu’elles sont capables de générer de la violence sociale ». Il observe que la virilité est une vertu, mais pas une vertu morale, elle est liée à l’identité sexuelle. Le fait de ne pas être viril est une atteinte au fait d’être un homme. La lâcheté, la fuite est immédiatement associée au manque de courage, de virilité. « L’équation fuite-peur = lâcheté est tellement inscrite dans notre culture qu’hommes et femmes, en majorité, associent identité sexuelle masculine, pouvoir de séduction et capacité de se servir de la force, de l’agressivité, de la violence ou de la domination. Ces pour ces raisons que ces dernières peuvent passe pour des valeurs. »
Le « cynisme viril » est intégré dans une stratégie de défense collective. « La stratégie collective de défense consiste à opposer à la souffrance à faire les basses besognes un déni collectif. Non seulement les hommes ne craignent pas la honte, mais ils la tournent cette dernière en dérision. » Il note un complément à ce déni, la mise en scène de la virilité d’où « on sort grandi par l’admiration, voire l’estime, voire par la reconnaissance des pairs, comme un homme - ou une femme ! - qui en a [du culot, de la détermination, des couilles] ! » Il existe des pratiques de conjuration qui ressemble à ce qui se passe dans les salles de gardes en médecine ou des bizutages des grandes écoles. Ceci explique pourquoi les entreprises sont souvent assez larges avec certains de leurs cadres en séminaires, repas d’affaire ou voyages, c’est dans ce cadre que le cynisme viril se maintient et s’entretient.
Tout cela est englué dans l’idéologie défensive du réalisme économique. « En ces temps de « guerre économique » on n’a pas besoin de bras cassés! Pas d’état d’âme ! La boucle est bouclée, lorsque la stratégie collective de défense rejoint le processus de rationalisation (au sens donné plus haut) pour l’alimenter et s’en nourrir. On est alors dans l’idéologie défensive, et la violence se profile à l’horizon. »
La rationalisation du mensonge est indispensable à l’efficacité du mensonge. Ceci permet de tromper le sens moral sans l’abolir. L’obéissance aux ordres, dans ce cadre devient une décharge de responsabilité. Le poids de la légitimité économique après coup renforce la rationalisation. La société civile n’est pas informée directement de toutes ces pratiques, des usages banalisés du mal. Si une affaire éclate elle passe pour exceptionnelle alors que c’est la normalité ambiante.
Dejours se penche sur l’aliénation. Il pense que sa puissance n’est pas due seulement à l’intériorisation mais aussi aux stratégies de défense. La fermeture dans le domaine psychologique de l’accès à la sublimation favorise l’émergence de la compulsivité de la violence. Son interrogation fondamentale émerge alors : le travail du mal est-ce le travail du mâle ?
C’est en quelque sorte la conclusion de ses recherches. « Le ressort de cette activité n’est manifestement pas la perversion, mais la gestion plus rationnelle du rapport entre tâche et activité, entre organisation prescrite et organisation réelle du travail. »
Il n’y a pas de plaisir à faire mal ici, c’est au contraire le résultat d’une exécution technique d’un travail, c’est une gestion technique et rationnelle. Il s’agit d’une activité désérotisée où la violence fonctionne comme sublimation. Comme la banalisation du mal a lieu dans le cadre du travail on la vit comme une « mission » qui sublime la signification. La virilité est nécessaire pour lutter contre la peur. La validité du courage est donné par autrui. Il y a bien une intrication entre la virilité et la contrainte lié au travail.
Tout ceci fonctionne en prenant appui sur un discours de la maîtrise, maîtrise de soi, maîtrise du monde, maîtrise de la nature. Dans le discours féminin c’est différent. Une étude sur le milieu des infirmières montre que le primat du réel est fondamental. Les défenses collectives face à la douleur fonctionne comme un encerclement de ce réel. Chez les hommes c’est le déni qui est primordial. « Compte tenu de la place capitale qu’occupe la virilité dans la distorsion sociale qui fait passe le mal pour le bien, il faut admettre que, lorsque existe une contrainte ou une injonction à surmonter la peur, les processus psychiques individuels et collectifs font davantage appel à la virilité défensive qu’au courage moral.» Le contexte de la menace est indissociable de tout cela. Ce thème on le rencontre un peu partout, pour la suspicion vis à vis des personnes étrangères et jusque dans les collectifs militants ou les mouvements de lutte.
Il note une réversibilité entre la position de victime et celle de bourreau. Cette notion de réversibilité est à noter. Les juifs sont devenus les bourreaux du peuple palestinien, c’est indéniable. A mon avis, ceci fait question pour nous, pour la militance : il est exact qu’une victime peut toujours devenir bourreau, nous en avons multiples exemples.
Si on suit l’auteur, il faut déjà refuser le déni de la souffrance afin que la rationalisation ne fonctionne plus comme mécanisme de défense sur le plan collectif, mais est-ce suffisant ? Attaquer les manifestations de virilité est un moment possible, reste la volonté de vérité qui lie l’autorité à l’organisationnel. Là c’est plus délicat pour la militance, me semble-t-il.
La virilité est sollicité quand il faut faire face à la peur. Cette conjoncture est banale dans notre société. « A chaque fois que l’un ou l’autre doit infliger de la souffrance à autrui, c’est au nom du courage et de la virilité. La virilité, c’est le mal rattaché à une vertu - le courage - au nom des nécessités inhérentes à l’activité de travail. La virilité, c’est la forme banalisée par laquelle on exprime la justification des moyens par les fins. La virilité est le concept qui permet d’ériger le malheur infligé à autrui en valeur, au nom du travail. » Au nom du travail oui mais ce peut être au nom d’autre chose : la lutte contre les faschos, la lutte contre les traîtres, etc.
Dejours est partisan de « requalifier la souffrance ». Ses conclusions me semble valable dans beaucoup de domaines : « Il n’y a pas de banalisation de la violence sans la participation large à un travail rigoureux sur le mensonge, sa constatation, sa diffusion, sa transmission et surtout sa rationalisation. »
Pour lui il est nécessaire : de débanaliser le mal et attaquer la virilité comme mensonge, de déconstruire la violence organisationnelle, de parler de la souffrance, d’arrêter de faire l’éloge de la peur et de prôner la fuite, de reprendre l’étude de la philosophie et de l’éthique sous l’angle de la critique de la virilité.
Il faut agir et penser contre la gloire qui est conjointe de la virilité. Pour cela il est important : d’être attentif à la souffrance et de développer la perception à la souffrance chez soi et chez autrui, de promouvoir le courage comme le fait de s’opposer à la souffrance et non pas de l’infliger, d’être prudent-e dans les rapports humains, de valoriser l’obstination et la pudeur qui d’habitude sont considérées comme des valeurs féminines et de fait plutôt dévalorisées, de ne pas dénier la souffrance quand elle tente de s’exprimer.
Il estime qu’il est temps de s’opposer au recours à la violence, de refuser la rationalisation de la virilité comme mode de domination. Il existe une complémentarité entre les décisions du sommet, des chefs et les comportements de la base qui se soumet aux ordres et pour qui il est important d’avoir bien agi et d’être ainsi reconnu socialement. Il se prononce contre la banalisation du mal, contre la dédramatisation du mal.
En conséquence il serait donc normal de dramatiser la souffrance pour qu’elle puisse être prise en compte. Ceci renvoie également aux différentes façons de vivre la souffrance suivant sa culture d’origine, son éducation ou le niveau admis par une société donnée située dans l’espace et le temps. Son propos se situe dans le monde du travail. Il faut peut-être nuancer le propos car dans la société actuelle on constate une évolution dans l’acceptation du seuil de souffrance. Souvent ce seuil est s’abaisse dans la santé, en particulier, avec l’attitude consumériste et la fin du mythe du progrès (parce que la souffrance n’a plus de sens pour un avenir meilleur).
Dejours juge la mobilisation de la violence et les mobilisations violentes comme néfastes. La peur est un moteur important. Il voudrait que l’on étudie le ou les comportements collectifs liés à la violence. La question fondamentale reste l’acceptation de la violence virile, la soumission librement acceptée. Ceci pose le problème de la rationalité qui justifie encore et toujours cette violence. Contre le mépris des personnes et le cynisme, il met en évidence le poids des modèles qui font de la violence virile une banalité de notre monde. Il pense qu’il faut parler de la psychopathologie de la souffrance comme de celle du plaisir dans le sens commun.
Il utilise les travaux d’Annah Arendt sur le cas Eichmann pour savoir comment un être humain d’apparence et de comportement normal dans son cercle restreint peut accepter de conduire une politique d’extermination comme celle de la Soah. Il pose la question des études théoriques et pratiques sur la souffrance et son acceptation tant du point de vue des personnes qui la subissent que de celui des personnes qui la mettent en oeuvre.
Avec l’étude de la banalisation du mal on peut voir que l’action est une triade : action, activité et passion. Cela c’est la base de « la vie de l’esprit». Pour lui c’est un problème éthique, que nous devons essayer de résoudre en nous éveillant à ce qu’il appelle la vie de l’esprit. Ici cette notion me fait penser à nécessité de la pensée critique, à l’autonomie de la pensée et de l’action développée par certaines personnes (Castoriadis entre autres). Cette approche implique de penser par soi-même et de réhabiliter la politique. Ceci évoque aussi le au problème du rapport entre les mots et les actes que nous avons déjà rencontré dans notre militance, au problème éthique posé par le rapport entre les moyens et les fins. On peut aussi voir cette vie de l’esprit comme la nécessité d’une vie intérieure (raison et émotions). Vie intérieure qui ne serait pas celle de la spiritualité religieuse, mais qui s’opposerait à la transparence de l’individu-e basée sur l’intérêt et le spectacle, transparence qui n’a pas besoin d’un panoptique physique et matériel, mais qui fonctionne sur l’adhésion mentale aux valeurs, aux images identificatoires si nombreuses sur nos murs et nos écrans, au sens commun du système. Du point de vue libertaire la vie de l’esprit se rapprocherait de la notion de sujet, au sens où celui-ci essaie en situation de comprendre et de transformer ce monde inique et absurde par la participation à un ou des projets collectifs de solidarité et de lutte.
Le livre de Dejours est à mettre en rapport, à mon avis, avec celui de Beauvois sur « La servitude libérale ». Celui-ci insiste sur la déclaration de liberté et sur la rationalisation. Celle-ci permet de donner de la valeur à notre être et de justifier notre soumission. Cette rationalisation s’oppose à la rationalité, puisqu’elle justifie un processus en partie irrationnel et inconscient. La complémentarité entre la sphère personnelle et les sphères idéologiques et culturelles est patente. Le personnel est politique, au sens où la domination a ses relais en nous mêmes, dans notre subjectivité : la virilité. On peut se référer aux travaux de Foucault sur la micro-physique du pouvoir et la biopolitique ou à la notion de double articulation du symbolique développée par Edouardo Colombo en 1984. N’oublions pas Freud pour qui le « tenir pour vrai » est dépendant d’un investissement affectif, existentiel.
De M. Philippe Coutant